 Vue
Est-Ouest du village en 1925. On voit en arrière-plan la cheminée
de l'usine. Vue
Est-Ouest du village en 1925. On voit en arrière-plan la cheminée
de l'usine.
|
Le nouveau village a été
quasiment reconstruit selon le même plan. C'est la brique rouge qui
lui a donné un nouveau visage. Pourquoi ? Les forêts sont
rares et n'étaient pas exploitables dans la région. Le bois
ne fut donc pas privilégié. La pierre de taille calcaire
était trop coûteuse. Le torchis, cet enduit naturel et traditionnel
que nous avons décrit dans une autre partie, ne fut pas non plus
employé. Il était facile à produire sur place mais
réclamait une main d'oeuvre spécialisé.
|

La mairie et la place
de la mairie.
|
La brique rouge était quand
même fréquente avant la guerre. Mais son usage était
limité par exemple aux bâtiments collectifs ou récents.
Au cours de la reconstruction, elle a été massivement utilisée.
Elle ne fut pas uniquement choisie par défaut. Elle avait aussi
ses propres avantages.
|

Au fond, la nouvelle
église, sur la droite, le bureau de poste.
|
Tout d'abord, un ouvrier pouvait vite
apprendre à construire un mur en brique. Enfin et surtout, l'argile
nécessaire à sa fabrication est présente naturellement
dans le sol. Cela permettait de produire les briques sur place et limitait
donc les coûts. Elles étaient fabriquées dans des briqueteries
(on en comptait 55 dans la Somme) ou en meules. C'est-à-dire des
fours provisoires qui produisaient des briques de moins bonne qualité.
|

Rue de Villers, à
gauche l'un des bâtiments des écoles. Les écoles sont
en arrière de la mairie.
|
Le même changement se produisit
pour les toitures. Les pannes, des petites tuiles en formes de S écrasé,
furent abandonnées. Elles furent remplacées par les tuiles
mécaniques rectangulaires et plus orangées. L'ardoise était
trop chère et les tuiles se fabriquaient comme les briques. Elles
offraient les mêmes avantages.
|

La nouvelle église
: ardoise, brique et béton.
|
Aujourd'hui, il est facile pour un
étranger ou pour quelqu'un qui ne connaît pas le passé
de la région de souligner la monotonie ou l'absence de charme de
certains villages de la Somme par rapport à ceux d'autres régions.
C'est tout simplement une des marques laissées par la guerre. La
brique a tout de même permis d'éviter un recours excessif
au béton et au ciment.
|
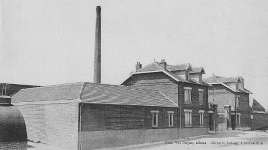
L'usine reconstruite
en 1921 et sa cheminée. A gauche, on peut voir l'arrière
de l'église provisoire.
|
De nouvelles réglementations
supposées améliorer l'hygiène et la santé furent
aussi décidées. Les conséquences de l'une d'elles
se voient dans les constructions de l'époque : les plafonds devaient
être à 2,50 m et les fenêtres devaient mesurer 1,50
m pour une meilleure aération. Des maisons difficiles à chauffer
l'hiver... Par conséquence, les nouvelles maisons n'avaient plus
l'aspect ramassé qu'avait celles d'avant la guerre. A ce propos,
au Hamel, beaucoup de bâtiments ont le même style. On peut
le voir en observant les plus grands bâtiments datant des années
20. Notamment les pignons et les toits. Elles ont très certainement
eu le même architecte.
|

L'intérieur de
la nouvelle usine : les ouvriers, les métiers à tisser avec
leur système de poulies et de courroies.
|
Cette période fut aussi l'occasion
d'introduire certaines améliorations au Hamel comme ailleurs. La
nouvelle école dispose d'un grand préau, de toilettes et
de lavabos. On travailla aussi à l'installation d'un réseau
d'eau potable. Des bornes fontaines furent installées dans les rues
puis, à la fin des années 30, chaque habitation fut reliée
à ce réseau. De même pour l'électricité.
Pour les habitants les plus modestes, l'installation d'une salle de bain,
de toilettes à l'intérieur ou d'autres améliorations
restaient encore beaucoup trop chère.
|